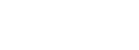Psychosomatique
Le terme de « psychosomatique », qu’il qualifie une maladie, un trouble, un symptôme ou un sujet, est porteur d’une ambiguité fondamentale dans la tentative qu’il propose de relier les deux mondes irréductiblement hétérogènes et dissociés l’un de l’autre que sont le somatique et le psychique.
Depuis l’opposition de la res extensa et de la res cogitans de Descartes, mais déja dans le difficile projet d’établir une cohérence à la relation entre l’âme et le corps qu’avançait l’Antiquité grecque avec le concept de mélancolie (bile noire), théories scientifiques ou philosophiques, doctrines religieuses n’ont cessé d’essayer de formaliser une impossible articulation entre ces deux entités finalement irréductibles l’une à l’autre, à moins de se résoudre à résorber l’une par l’autre.
La psychanalyse s’intéresse au corps à l’occasion d’une demande dont celui-ci se fait le support, ou lors de ses manifestations dans le déroulement de la cure ; c’est en tant qu’il est connecté à des phénomènes de langage qu’elle l’inclut dans son champ et non dans une démarche qui viserait à s’agglutiner au monde des neurosciences. C’est ce que rappelle Lacan dans « Radiophonie », soit qu’il « revient d’abord au corps du symbolique qu’il faut entendre comme de nulle métaphore. A preuve que rien que lui n’isole le corps à prendre au sens naïf, soit celui dont l’être qui s’en soutient ne sait pas que c’est le langage qui lui décerne, au point qu’il n’y serait pas, faute d’en pouvoir parler. Le premier corps fait le second de s’y incorporer. » (8, p. 61).
La conversion somatique hystérique en est le paradigme puisqu’elle met en scène les modalités de prise du corps par le langage, et fournira la matrice de ce que la théorie psychanalytique élaborera avec le concept de « symptôme ». Ainsi donc, pour la psychanalyse, le symptôme est signifiant et, inversement, sera réservée l’appellation de symptôme à ce qui est signifiant, et non pas signe comme c’est le cas pour la médecine.
La dénomination de « symptôme » psychosomatique devient de ce fait incongrue lorsqu’elle prétend recouvrir un certain nombre de phénomènes et manifestations du corps dont la dimension signifiante, au cours de la cure, s’avèrera problématique.
La médecine et la psychologie ont, on le sait, légué ce terme pour dénoter d’une part l’incapacité (toujours alors fantasmée comme provisoire) à établir une étiologie organique biologique univoque à une manifestation corporelle morbide et d’autre part la nécessité de lui inférer une causalité psychologique pour combler le vide laissé par l’énigme de sa genèse. C’est dans cette mesure que la médecine peut prétendre récupérer dans ce discours la conversion hystérique et soumettre plus globalement toute expression somatique, dont le déterminisme est supposé d’ordre psycho-affectif, à l’épreuve de la signification.
La psychanalyse s’en démarque pour soutenir une logique du sens, mais dans la mesure où son effet advient dans la chute d’un signifiant lors de l’opération métaphorique ; c’est de l’échec d’un tel processus que surgit la difficulté d’aborder le phénomène psychosomatique, dans la mesure où il se différencie ainsi du symptôme de conversion.
Contrairement à ce dernier, la perturbation dite psychosomatique n’est repérable ni par sa face signifiante, ni par celle d’un contenu signifié. Elle n’est signe pour personne, telle en témoigne la butée des enquêtes médicales à son propos, qui la renvoient dans ce « no man’s land » du champ médical alors dénommé de psychosomatique (le recours à la dimension psychologique ne traduit que l’impuissance du discours des médecins à l’intégrer dans l’univers sémiologique) ; son caractère signifiant se dérobe dans son incapacité à s’écarter d’un autre signifiant pour représenter un sujet ; quant à la constellation et la confluence en lui d’éventuels signifiants de l’histoire du patient qu’on y lira plus ou moins aisément, elles échoueront à produire cet effet d’élision métaphorique ; on ne se situe pas ici dans la logique du retour du refoulé.
Cette opposition reste schématique, car la clinique enseigne qu’on ne peut ainsi démarquer de façon aussi abrupte les symptômes somatiques « dignes de ce nom », de ceux que nous continuerons à dénommer, faute de mieux, troubles psychosomatiques, dont la prise par le langage reste obscure ou seulement supposée (ce qui permet bien évidemment de supposer le contraire).
D’ailleurs, cette disparité est tout à fait observable pour une même manifestation somatique, dont le statut peut varier à une période précise ou à des époques différentes de la cure et de l’existence du patient. Notre intérêt ne se portera donc, sous cette appellation « psychosomatique », que sur cette dimension dont la congruence au langage demeure problématique pour un ou des phénomènes somatiques donnés.
L’organe souffrant et qualifié de « malade » est exclu de l’unité (imaginaire) du corps, de son image unifiée, ou s’y présente tout du moins comme une aberration, une tache opaque hors cadre sur le tableau, ou comme ce qui menace ce cadre d’éclatement et le rend dérisoire. Il saisit le regard en l’immobilisant et l’absorbe dans un piège sans réponse, obscurcit l’attention et tarit la pensée qui se réduit à un langage mécanique et dévitalisé, éventuellement emprunté au savoir scientifique, et s’assèche en une plainte répétitive, litanie désespérante de mots indéfiniment réplicables et semblables à eux-mêmes. Le discours se réduit à une rengaine obstinée d’où aurait disparu toute mélodie, ne débouchant que sur sa mortifère perpétuation, au point même où les possibles modulations de la souffrance se résorbent dans l’immobilité de son insistance.
La description souvent méticuleuse du viscère douloureux ou du dysfonctionnement parasite vise à en cerner les contours avec une exactitude absolue pour tenter d’en asseoir l’irrécusable existence et le précipiter en une chose, et rien que cette chose, d’une présence sans recours visant à balayer toute équivoque, d’une visibilité étincelante où aucune ombre ne vient atténuer l’aridité laissée par l’abandon de toute libido.
Cette évocation du trouble psychosomatique se fait volontiers ainsi de la part du patient sur un mode objectivant et impersonnel, témoignant du retrait ou de l’absence du sujet de ce qui s’énonce.
Il est banal de dire que le fonctionnement imaginaire de ces patients souffrant de troubles psychosomatiques était particulièrement appauvri, voire quasi inexistant ; si cette affirmation se vérifie dans certains cas, elle n’en est guère spécifique ; c’est plutôt l’imaginaire concernant le phénomène somatique lui-même localisé à une partie du corps ou une fonction qui s’avère singulièrement réduit. Hormis ses coordonnées chronologiques ou conjoncturelles de survenue, quelques critères éventuels de ressemblance, aucune histoire, aucun récit, aucun roman ne viennent faire contrepoids à ces descriptions morbides auxquelles il était fait allusion ci-dessus.
Quelles que soient les modalités particulières de l’expression clinique de ces troubles, surviendra immanquablement, nous l’avons déja évoqué, la question de leur sens, dans l’acception la plus large de ce terme, c’est à dire bien entendu en tant qu’implication d’un savoir inconscient, mais également en tant que signification dont on sait que l’indéfinie recherche métonymique qui l’alimente forge la trame du discours dans lequel on attend, parfois indéfiniment, le surgissement de la métaphore.
L’ensemble des différentes théories cherchant à rendre compte des troubles ou maladies psychosomatiques se distribuent autour de cet axe central du sens, qui leur est variablement accordé avec plus ou moins de prodigalité ou au contraire refusé, s’écartant là encore plus ou moins du modèle de la conversion hystérique ; on ne peut d’ailleurs que remarquer que, proportionnellement à la distance qui les éloigne de celle-ci, les manifestations psychosomatiques se voient remblayées et comblées de significations s’accumulant indéfiniment, dans la bouche au moins du médecin ou de l’analyste impuissant, voire du patient, au point de devenir le réceptacle d’un trop plein de savoir, aussi inutile que prolifique.
La problématique du sens n’est pas dissociable de celle de la représentation, qu’il s’agisse de celle que promeut la pensée classique ou de ce qui permet à un sujet de se soutenir à partir de deux signifiants.
La notion de représentation et de représentant est évidemment liée dans l’oeuvre de Freud au fameux représentant psychique de la pulsion, et situe son embarras à cerner la pulsion entre, ou à la limite, ou dans la béance, etc. du somatique et du psychique, de même que le problème de l’intrication de la satisfaction de la pulsion et de celle du besoin (l’utilisation d’ailleurs du même vocable de « satisfaction » contribue à entretenir une grande confusion entre ces deux champs qui réfèrent à des expériences bien différentes).
L’introduction du concept de jouissance est, on le sait, une tentative proposée par Lacan pour contourner cet autrement irréductible dualisme du soma et de la psyché, en ne retenant du corps qu’une « substance jouissante » (9, p.26). Cette jouissance est marquée, du fait du langage et du signifiant, par une déperdition primordiale, à partir de ce qui serait une jouissance pleine du corps, et s’organise autour des différentes modalités pulsionnelles, dans une sorte de logique de compensation, pourrait-on dire.
Or, c’est précisément à ce niveau que se situe la butée du phénomène psychosomatique. Ainsi le formulait Lacan dans sa conférence de Genève en 1975 : « La question devrait se juger au niveau de - quelle est la sorte de jouissance qui se trouve dans le psychosomatique ? Si j’ai évoqué une métaphore comme celle du gelé, c’est bien parce qu’il y a cette espèce de fixation… M. Vauthier : il y a quelque chose de paradoxal. Quand on a l’impression que le mot jouissance reprend un sens avec un psychosomatique, il n’est plus psychosomatique… Lacan : tout à fait d’accord. C’est par ce biais, c’est par la révélation de la jouissance spécifique qu’il a dans sa fixation qu’il faut toujours viser à aborder le psychosomatique » (10).
C’est bien à une interrogation de fond quant à ce concept de jouissance et de ce qu’il ordonne que nous contraint le champ de la psychosomatique, et donc à la question à nouveau posée et renouvelée du statut du dualisme de la psyché et du soma.
90° à 120° longitude est - 45° à 20° latitude nord
Il est fréquent d’attribuer à la pensée chinoise un regard unifiant sur le corps et la psyché, qui les noierait dans une sorte d’entité imprécise, à résonance plus ou moins métaphysique, à l’image de ce que prônent un certain nombre de courants de pensée tout autant à la mode qu’hasardeux en Occident.
Il est un fait que, selon les textes, selon les occurences et les contextes, psyché et soma sont soit clairement différenciés - quand cela parait utile ou nécessaire à l’argumentation - ou bien semblent pris en compte à un même niveau au point que leur différenciation ne devient plus pertinente ; c’est alors moins de leur unification sous un concept tiers qu’il s’agit que d’une non identification de leur existence épistémologique respective. Les ouvrages de médecine traditionnelle chinoise pullulent de ces deux genres d’exemple, ce qui témoigne par conséquent d’une autre logique à l’oeuvre.
Si un certain hédonisme traverse la pensée de Freud (ce qui, bien entendu, ne conduit pas à faire de l’éthique de la psychanalyse une éthique hédoniste) sans lequel un concept, tel que celui de la jouissance, n’aurait pu ainsi fructifier, même pour s’en démarquer, il est incontestable qu’un tel hédonisme, lui aussi non absent de la pensée chinoise, y est envisagé sur un mode bien différent ; conception dont la particularité n’est pas étrangère, bien au contraire, à un découpage et une figuration tout à fait autre du corps.
Que l’on considère le langage en tant qu’il consomme la perte de la chose, qu’il consacre la perte de cohésion du corps organique où soma et psyché ne sont initialement pas différenciés, qu’à partir de là s’instaure la dialectique de l’objet perdu et/ou de l’objet manquant, implique d’une part que rien ne se conçoit indépendamment d’un point d’origine aussi réel que mythique et d’autre part que l’activité de marquage du signifiant ne soit pas dissociable d’un effet de coupure. On connait le succès de ce terme de "coupure", mais l’on pourrait tout aussi bien le remplacer par « brèche », ou d’autres encore, et, pourquoi pas par le terme chinois de « fen", intraduisible en tant que tel par un seul mot, mais pour lequel le dictionnaire Ricci (12) propose les mots français suivants : diviser, fractionner, répartir, partager, distinguer, différencier, discerner (comme pour tout caractère chinois, il peut autant s’agir d’un verbe que du substantif correspondant, donc à cette liste de termes, il faudrait ajouter : « division, partie, etc. ») ; dans l’étymologie de ce caractère, il est question, pour sa partie inférieure (radical), d’instrument tranchant, de couteau, de sabre, d’un instrument primitif en silex, et pour sa partie supérieure, de division en 2 (isolée, cette dernière partie signifie « 8 »).
Or, il s’agit, avec cette notion de fractionnement et de partition, d’une des caractéristiques principales non seulement de l’activité désignatoire de la parole en général, mais également de celle dont la parole que l’on pourrait qualifier, dans l’univers chinois, de « juste », tend par contre à se déprendre. Ce mot de « juste » réfère à la notion de « milieu », dont les descriptions du corps nous donnent une illustration. Quelques précisions s’imposent à son sujet :
Notons d’emblée qu’il n’existe pas en chinois (ancien, c’est à dire hors de toute influence occidentale) de terme générique pour désigner le "corps", mais au contraire un grand nombre de mots qualifiant le corps selon divers aspects et diverses fonctions, variant avec le contexte, ne pouvant être rassemblés sous un seul concept et une unique dénomination.
Des utilisations très différentes de la métaphore corporelle pour évoquer l’organisation de l’état illustrent d’autre part les divergences de point de vue entre le monde occidental et la tradition chinoise quant à leurs conceptions du corps : si, en Occident, le Roi peut être comparé à la tête et les sujets aux membres, ainsi que le rappelle Kantorowicz (7), dans la Chine classique, l’Empereur est le coeur, le centre, mais en tant que ce centre est ubiquitaire, et se situe tant au milieu qu’à la périphérie. A l’ubiquité de ce centre-milieu répond cette absence de concept unificateur des « corps ».
Le coeur chinois - l’Empereur - est le milieu : ce milieu cependant ne se réfère pas à un lieu fixe et une position atemporelle, sous tendus par une essence, au delà de ses accidents substantiels, mais au fonctionnement d’un processus en cours, épousant les contours d’une situation ou d’une conjoncture en permanentes transformations. Ses coordonnées spatio-temporelles ne sont jamais figées, et varient selon le contexte concerné. Ces mutations sont l’effectuation d’une alternance entre le potentiel et l’actuel, nous y reviendrons. L’Empereur ainsi se déplaçait dans toutes les parties de son Empire jusque dans ses confins les plus extrêmes, les plus "périphériques", et résumait cette fonction primordiale en parcourant rituellement 9 salles de son palais figurant de la sorte ce cheminement indéfini. Le milieu n’est pas un trône immuable, ni même un attribut de droit divin ou conféré par une quelconque transcendance ou entité métaphysique, donc absolutisé, mais le principe initiateur et inducteur de toute mutation.
De plus, si l’on souscrit à la formulation selon laquelle le corps est Autre et est indissociable de l’Autre, et si le corps chinois, bien qu’impliquant avant tout une pratique corporelle tangible préalable à tout discours sur lui, ne peut évidemment se réduire à une pure sensorialité (où se résorberait cette altérité), l’Autre, dans le monde chinois, n’est pas de l’ordre - qui sous-entendrait une dialectique d’intériorité et d’extériorité, c’est à dire d’une frontière et d’une discontinuité. L’Autre est du registre d’un devenir, et, à cet égard, le corps l’est aussi.
La dualité enfin ne se situe ni entre le corps et l’esprit, ni entre Eros et Thanatos, ni entre le monde des phénomènes et celui des Idées (platoniciennes), ni entre l’être et le non-être, mais entre le potentiel et l’actuel, dans un enchaînement sans fin, où ils sont à la fois alternants et inextricablement mêlés, sans notion d’une essence qui perdurerait au delà de la disparition du monde visible.
Le corps ne s’appréhende que comme transformation et lieu de transformation, en tant que devenir et participant à un processus mutatif général ; le discours produit sur le corps ne rend compte d’aucune expérience particulière, mais se limite à tracer les contours du cadre dans lequel ce dernier se définira comme aboutissement (temporaire et conjoncturel) d’une mutation en cours. Le milieu est à la fois lieu et moteur de ces transformations.
C. La parole et le corps parlé
Comment donc cette problématique de la parole est-elle abordée dans les textes classiques chinois ?
La parole est ainsi évoquée par Zhuang zi (ive siècle avant JC), l’un des auteurs essentiels du courant dit du taoïsme philosophique : « La raison de la nasse se trouve dans le poisson (/la nasse existe du fait du poisson) : quand on a pris le poisson, on oublie la nasse ; la raison du lacet se trouve dans le lièvre (/le lacet existe du fait du lièvre) : quand on a pris le lièvre, on oublie le lacet. La raison de la parole se trouve dans le sens à exprimer (/ les mots existent du fait du sens) : quand ce sens est atteint, on oublie la parole (/les mots). Quand trouverai-je quelqu’un qui oublie la parole (/les mots) pour dialoguer avec lui ? (/pour échanger un mot avec lui) » (chapitre 26, traduction F. Jullien, (5) p. 355 ; entre parenthèses, les nuances de traduction par rapport à la précédente, par B. Watson, (18) p. 302).
La nasse est l’analogue de la parole, le sens celui du poisson ; cet apologue met en épigraphe le rôle parfaitement ambigu de la parole dont il faut se garder tout autant que de ne pas ignorer le statut nécessaire et incontournable.
Egalement, du même Zhuang zi (chapitre 33) : « S’exprimer dans un langage absurde et emphatique, dans des termes excentriques et extravagants, avec des expressions sans queue ni tête, s’abandonnant parfois à être totalement licencieux sans esprit partisan (ou « sans hasard » ?), sans envisager les choses selon un point de vue pariculier. Considérer que le monde est englouti dans une turbidité boueuse, et qu’il est impossible de l’aborder avec des propos sérieux. C’est pourquoi on utilise un langage instable pour que se déploient les changements sans fin (/pour un déploiement illimité), des paroles répétées pour délivrer une atmosphère d’authenticité, et des propos allusifs pour communiquer la plus grande vastitude » (traduction personnelle).
Outre l’éloge de la parole extravagante, Zhuang zi fait également celle de la parole circonstancielle, comme par exemple dans le chapitre 27, intitulé « Paroles allusives » : « Avec ces propos instables comme la coupe inclinée et qui changent selon les circonstances qui s’écoulent jour après jour, on s’harmonise par la non opposition avec les processus du monde, suit les changements sans fin et ainsi s’écoule la vie dans tous ses confins. Aussi longtemps que l’on ne dit rien, tel se déroule l’harmonisation avec le procès des choses. S’harmoniser avec des paroles, alors il ne s’agit pas d’harmonie, parler en s’harmonisant alors il ne s’agit pas d’harmonie. C’est pourquoi on dit qu’il ne faut pas parler. Avec des paroles qui ne sont pas des paroles, on peut parler toute sa vie et on n’aura jamais rien dit ; ou si l’on passe sa vie sans parler (ainsi), on n’aura jamais cessé de parler. » (C’est pourquoi on dit : ne pas parler ; parler sans parler toute sa vie, c’est ne pas savourer/expérimenter la parole ; ne pas parler durant toute la vie, ce ne sera jamais ne pas avoir parlé) (18, p. 304).
Cela revient à enrayer toute parole qui implique une désignation parcellaire, ce qui n’est pas le moindre paradoxe ; la parole doit laisser passer, soit ne pas s’opposer au déroulement de la réalité des choses, autre formulation bien équivoque, mais qui, de par ce fait, peut n’être pas frappée d’emblée de caducité.
C’est ainsi que ces textes classiques se présentent essentiellement comme des recueils d’apologues, d’intuitions présentés selon des formules elliptiques rebelles à toute explicitation (et traduction) définitive, à toute totalisation, volontiers indécidables quant à un sens ou une lecture conceptuelle prépondérants.
Le propos ne se laisse jamais figer, et est en perpétuelle transformation, et n’évoque lui-même que la transformation des existants (au moins pour ce qu’il en est de ces textes classiques exemplaires), toujours transitoire, variable et modulable, au renouvellement inépuisable pour ne finalement signifier que la seule chose qui ne cesse pas, c’est le changement.
La logique interne au langage et les contraintes qui lui sont inhérentes ne sont cependant pas déniées ; elles sont tout au contraire utilisées pour que surgisse l’imprévu.
De très nombreux exemples pourraient illustrer ce qui peine ainsi à se résumer. Des arguments philologiques divers viendraient de la même façon étayer ces considérations ; ne citons, que pour exemple, la façon dont le Lao zi (autre grand texte taoïste fondamental, sans doute du iiie siècle avant JC dans la version qui en est connue) distingue le caractère ming qui signifie « nom, appellation, désignation », du caractère zii qui signifie « caractère, mot » ; il ne faut pas y voir une différenciation de la parole et de l’écriture (au moins dans ce contexte), mais deux logiques différentes : dans celle du ming, un mot tel que da qui signifie « grand », introduit l’idée de grandeur par rapport à la petitesse ; dans la logique du zi, le même caractère da signifie « grand » dans sa connotation d’amplitude illimitée, dans sa formulation la plus vaste et moins contrainte que la précédente ; mais bien entendu, un tel exemple ne vaut que dans le contexte précis où il apparait et ne saurait en aucun cas donner matière à une édification conceptuelle.
La parole se contente donc moins de désigner que d’indiquer (pour reprendre la formulation de F. Jullien), ainsi que l’explique le grand commentateur classique du iiie siècle après JC, Wang bi, dans son Laozi weizhi lilüe : « La dénomination détermine un objet tandis que l’indication suit ce qu’on veut dire… La détermination nait d’une caractérisation objective, l’indication provient d’une approche subjective. La dénomination ne naît pas du vide et l’indication n’en provient pas non plus. Aussi la dénomination rate-t-elle grandement le sens visé et l’indication n’arrive-t-elle pas à dire jusqu’au bout » (cité par F. Jullien, (5), p. 332).
Ainsi la parole « juste », que nous évoquions précédemment, oscille-t-elle entre désignation et indication, entre l’objectivation et le pointage de la tendance, pour tenter de converger vers la parole et le sens « allusifs » (notion développée par F. Jullien, 5). C’est une tentative d’expliciter - démarche vouée par essence à rater son but - l’idée chinoise de la « parole sans parole » dont il était question dans les citations précédentes. La parole qui est privilégiée est celle qui oscille tel un récipient qui, rempli, se vide, et, vide, se remplit ; elle est en arrondis successifs tel un « carré qui n’a pas de coins ».
Ces considérations établies à partir de textes de la tradition taoïste pourraient être, sinon superposées, en tout cas largement comparées à celles que l’on pourrait proposer à partir de textes confucéens ; si les penseurs liés à ce courant sont classiquement opposés aux taoïstes, étroitement attachés aux rituels et aux structures sociales là où les taoïstes se présentent volontiers comme de libres esprits se jouant des règles et des conventions sociales, un texte tel que celui des « Entretiens de Confucius » montre à quel point le discours peut tendre à la tautologie pour ne souligner que sa valeur énonciative, dans une dimension là encore fondamentalement allusive.
De la première lecture d’un tel texte peut se dégager une impression de grande banalité. Mais son conformisme et sa platitude apparents sont liés au souci de ne privilégier aucune thèse ni aucune position particulière, épousant les contours du procès du monde et des existants, où les termes restent rebelles à toute définition et tout enfermement conceptuel ; la structure en dialogue de ce texte sous formes de questions-réponses montre combien l’incitation prévaut sur tout souci de suggestion ou de désir de convaincre, où toute universalité est éliminée au profit d’une modulation propre à chaque interlocuteur.
L’exemple suivant en donne la quintessence : « Le duc Jing de Qi interrogea Confucius sur l’art de gouverner. Confucius répondit : que le souverain soit un souverain, le sujet un sujet, le père un père, le fils un fils… » (15, p. 67).
Le prédicat s’y confond avec le sujet ; il faudra connaitre le contexte historique pour saisir qu’en fait, le personnage interpellé, le duc de Jing, peut y entendre plus d’une remise en cause.
Si, ailleurs, aucun interlocuteur n’est nommément en jeu et qu’il s’agit de propos sur des notions plus générales, telles que par exemple les qualités de l’esprit humain, celles-ci ne sont jamais définies mais évoquées par une succession d’indications dont le point commun est d’être traversées par la qualité dont il s’agit.
De l’enseignement de Confucius, il n’y a rien d’ésotérique, il n’y a nulle spéculation : « Mes amis, vous pensez peut être que je vous cache quelque chose. Non, je ne vous cache rien. Il n’est rien de ce que je pratique que je ne partage avec vous : telle est ma vraie nature » (2, p. 65).
« Pratique » est la traduction d’un caractère qui évoque le mouvement, l’agissement, la marche (xing). Ce n’est pas seulement une position éthique qui est ici soulignée ; c’est une véritable implication de son propre corps que Confucius introduit de la sorte : l’interaction signifiée par le « partage » (yu), la participation, assigne, en leurs positions respectives, le corps de Confucius et celui de ses disciples, sa psyché et la leur, où la différenciation soma-psyché n’est, non pas inexistante en soi - mais sans guère de pertinence ; la catégorie de l’»en soi » s’efface d’elle-même.
Ce statut de la parole évoqué à travers quelques exemples tirés de ces philosophies classiques de la tradition chinoise n’a pas qu’un intérêt historique et théorique : il imprègne le mode de parler courant dans toute la civilisation chinoise et en structure la pensée quotidienne ; tout cela réfère certes à un univers culturel spécifique, mais néanmoins souligne une dimension propre à toute parole, fut-elle d’Orient ou d’Occident, pourvu que l’on s’attache à en faire valoir ses particularités dont nous venons de signaler les grands axes ; elles ne sont pas sans interroger l’usage que nous en faisons dans la prise en compte du discours sur le phénomène psychosomatique.
La technique dite des koâns utilisée dans la pratique du zen japonais (qui, à l’origine, était chinois), aphorismes paradoxaux et parfaitement équivoques proposés par le maître zen à son interlocuteur, au contenu à la fois apparemment général sans lien direct immédiat avec l’histoire ou le discours manifeste de ce dernier, mais introduits à dessein en fonction des dits ou des non dits du sujet, de son comportement, en est un paradigme remarquable (et serait d’ailleurs largement à même d’interroger l’intervention de l’analyste et le maniement du transfert).
L’écriture
Selon le point de vue que nous développerons maintenant, nous repartirons de cette difficulté donc, devant laquelle patient et analyste se rencontrent et à laquelle ils se heurtent : soit celle d’un trouble qui ne se laisse guère habiller des figures de rhétorique du langage ; l’immobilité dans laquelle le discours est figé ne semble pouvoir peut-être être levée que si l’on parvient à y introduire une certaine dimension que nous qualifierons d’esthétique ; la catégorie kantienne du beau, sensible à l’imagination bien qu’inintelligible à l’entendement, peut en être une première introduction ; c’est ici le beau en tant qu’il concerne et réside dans la forme : « le jugement esthétique n’est pas un jugement de connaissance ; il ne concerne aucun concept de la nature d’un objet, de sa possibilité externe ou interne, dérivant de telle ou telle cause, mais seulement le rapport des facultés représentatives entre elles, en tant qu’elles sont déterminées par une représentation » (6, p.152).
Cette référence kantienne, si elle présente l’avantage de souligner la dimension de la forme, bute nécessairement ici sur celle de l’imaginaire qui, précisément, en tant que liée au monde des images, fait défaut autour des phénomènes psychosomatiques.
Analogiquement, nous évoquerons l’embarras du commentateur d’art face à une oeuvre d’un peintre tel que Pierre Soulages, ainsi que le raconte Clément Rosset dans un hommage à cet artiste : « Pénible rôle en effet que celui du commentateur, qui reconnait entre mille une toile de Soulages mais échoue à définir son originalité, sauf à recourir à la tautologie… » ; il introduit alors une comparaison intéressante avec les écritures indéchiffrées : « Il existe, en dehors du domaine tenu pour spécifiquement artistique, des objets porteurs d’une telle signification énigmatique, c’est à dire à la fois et indiscernablement signifiants et non signifiants. Cas des écritures encore indéchiffrées - mais il est vrai que celles-ci se font maintenant rares. Cas aussi des écritures déchiffrées mais n’en demeurant pas moins muettes aux yeux du non connaisseur, qui n’y discerne à l’occasion qu’une évidente beauté graphique » (14, pp.29-30).
Nous verrons que l’on peut en faire d’emblée, avant de la développer, une allusion à l’écriture chinoise, à sa calligraphie et à sa peinture ; on y verra la forme prévaloir sur tout autre paramètre, dans cette écriture figurant pour le profane tant un infranchissable barbelé qu’exerçant une fascination abyssale, trace du corps qui l’a inscrite sur son support, forme avec laquelle ont si incomparablement su jouer certains artistes tel que le peintre coréen Ung No Lee, éclatant ces caractères chinois en objets insolites et éveillant le spectateur à l’endroit pour lui le plus inattendu.
Mais la comparaison avec la situation décrite par Clément Rosset entre le spectateur et la toile du peintre ne saurait être exploitée au delà : elle suppose en effet la délimitation et l’assignation préalable à deux places distinctes (au moins au départ) de celui qui regarde le tableau et du tableau lui-même ; c’est précisément la mise en scène que propose le patient entre lui-même - ou entre l’analyste mis en position d’observateur - et son corps souffrant, sans que cela ne produise pour autant un discours inédit ou la survenue d’émotions nouvelles en attente d’être parlées ; ce dispositif, que renforce l’analyse, peut même contribuer à barrer toute émergence à cette « beauté graphique » et tout jugement possible, esthétique ou autre : la tache noire prendrait alors la place de l’oeuvre d’art (pour reprendre l’exemple de P. Soulages).
Dans le trouble psychosomatique, le corps ne reçoit pas du langage - au moins au niveau de la lésion ou de l’organe malade - la marque qui l’introduit soit dans un registre érotisé soit dans celui du sens. Si marque il y a, elle n’est plus trace de quoi que ce soit. L’une des questions essentielles de la dimension psychosomatique semble être ce passage de la marque à la trace.
Dans sa conférence à Genève sur le symptôme, Lacan fait également référence à l’écriture à propos de la psychosomatique : « Il est certain que c’est dans le domaine le plus encore inexploré. Enfin, c’est tout de même de l’ordre de l’écrit. Dans beaucoup de cas nous ne savons pas le lire. Il faudrait dire ici quelque chose qui introduirait la notion d’écrit. Tout se passe comme si quelque chose était écrit dans le corps, quelque chose qui était donné comme une énigme » (10). Un peu plus loin, il fait référence à la théorie des signatures, et évoque enfin l’hiéroglyphe.
La difficulté est là située au niveau du déchiffrement énigmatique d’une sorte d’hiéroglyphe.
Cette question est, là encore, décentrée dans l’écriture chinoise, abordée d’un tout autre point de vue, selon une perspective dont il n’est peut être pas inutile de s’inspirer, au moins dans cet écart du hiéroglyphe et du caractère chinois, dans cette problématique psychosomatique.
Il n’est pas question de résumer ici le développement de l’écriture chinoise. Rappelons en simplement quelques caractéristiques remarquables, au premier rang desquelles l’essentielle disjonction entre le caractère calligraphié, son ou ses sens, et sa prononciation. De l’un ou l’autre de ces paramètres, on ne peut déduire les deux autres, et ce en dépit de la dimension partiellement pictographique de certains caractères.
De son origine divinatoire, l’écriture a gardé sa fonction primordiale de devoir établir une correspondance avec un évènement ou une action donnés (selon initialement son caractère faste et néfaste, dans un mouvement tendant à le qualifier plus qu’à le prédire) ; les inscriptions oraculaires primitives dont elle dérive étaient primitivement des pictographes, puis sont devenues des dactylographes correspondant, au départ, à des noms propres ; l’écriture ne fut jamais précédée de dessins : elle fut d’emblée écriture, la dimension idéographique n’étant que secondaire. Les premiers noms communs à apparaitre furent des termes évoquant l’action ou un comportement.
En fin de compte, ce qui importe ici dans notre propos est le fait que chaque caractère soit en prise directe avec un évènement correspondant ; plusieurs graphies peuvent rendre compte du même évènement, mais alors chacune précisant un élément contextuel particulier.
D’emblée se dégage la place essentielle que prendra le corps à travers chacun de ces signes graphiques : il est, nous l’avons dit, surtout question d’action et de comportement plus que de démarche conceptualisante. La forme y revêtera par conséquent un rôle de premier plan.
Laissons M. Granet illustrer ces quelques directions à peine ébauchées :
« La langue écrite dispose d’un immense matériel de signes chargés d’un contenu concret d’une richesse incomparable ; elle est restée un instrument merveilleux d’expression pittoresque… L’esprit chinois dispose, non pas d’une langue faite pour noter des concepts d’une abstraction ou d’une généralité variées, apte à exprimer toutes les modalités du jugement, et orientant enfin l’esprit vers l’analyse, mais, au contraire, d’une langue extrêmement attachée à l’expression pittoresque des sensations et où seul le rythme, dégageant la pensée de l’ordre émotionnel, permet d’ébaucher en une espèce d’éclair intuitif, quelque chose qui ressemble à une analyse ou à une synthèse… Eveiller dans l’esprit du lecteur un mouvement d’idées tel qu’il peut amener la reproduction de la pensée qu’on veut exprimer, ce n‘est point contraindre le lecteur à la prendre sous la forme définie dans laquelle on l’a conçue, c’est simplement le pousser à penser à un certain ordre d’idées, c’est simplement l’orienter » (4, pp. 119, 145, 154).
On ne saurait mieux mettre en relief le caractère profondément allusif, d’évocation dont il a déja été question ; on notera la prévalence de la forme sur le contenu : forme de l’ensemble du texte à travers une syntaxe, dans sa construction même où le procédé de la contre apposition de formules en parallèle ne variant que par un ou deux caractères tient une place essentielle, forme des caractères eux-mêmes calligraphiés et aussi topographiquement disposés à dessein d’une certaine façon sur la feuille de papier.
Le caractère d’écriture vaut plus par sa forme et son inscription à l’encre que par la signification qu’il serait censé arrêter ; l’activité du corps du calligraphe dont il témoigne et celle qu’il suscite chez le lecteur, isolément ou dans une suite où il s’enchaîne avec d’autres pour ne plus former qu’une seule figure sont en soi vectrices de sens, dans la mesure où ils indiquent une tendance ; cette activité du corps tient lieu, dans le processus de la représentation, de ce qui serait, dans la pensée occidentale, la conscience réfléchie.
Le mouvement qui en émane n’est pas le reflet d’un but extérieur préétabli et orienté vers un objet, qui pourrait être par exemple l’assignation d’une signification. C’est en ce sens que la pensée chinoise peut être dite morphologique, pour reprendre l’assertion de L. Vandermeersch (17), par opposition à une pensée téléologique.
L’activité du corps, ou tout aussi bien de la pensée, ne vise pas à la réalisation d’une idée ou l’obtention d’un objet prédéfini, mais à rencontrer la structure formelle du monde extérieur se trouvant mis en jeu par cette action, dégageant ainsi des correspondances, d’où émanera une production non déterminable à priori. Ainsi de l’acte du potier taillant le jade en suivant les veines de la roche émanera-t-il un objet inédit imposé par la structure interne de celle-ci et indépendant de tout modèle préconçu ; ainsi de la rencontre de son émotion et du paysage apparait sous le pinceau du peintre une calligraphie ou un tableau insoupçonnés, ou tout aussi bien un poème issu de la succession et de l’arrangement de plusieurs caractères, où phrasé des corps, des contours ou des rythmes, de la psalmodie qui en tramera la lecture ou la récitation traduit l’enchainement des formes qui forgent l’appréhension du monde par les chinois.
L’écriture produite ouvre un espace commun au scribe et au lecteur ; elle les dispose mutuellement et les affecte en tant que pôles d’une interaction dont elle est le fruit et qu’elle réalise tout à la fois ; l’image en tant que telle n’importe que comme trace d’une transformation à l’oeuvre, et non dans ce qu’elle immobilise d’un objet, comme apparition en acte et surgissement plus que comme oeuvre achevée (un même caractère xiang correspond à la fois à nos termes d’image et de trace).
Ce surgissement illustre la notion d’interaction, fondamentale à la structure de la pensée chinoise ; celle-ci ne considère pas le monde comme une succession d’états, mais comme une suite ininterrompue de transformations ; le caractère xiang (cf supra) correspond également à notre mot de « phénomène » ; les phénomènes du monde sont des transformations, et sont interaction entre deux principes, entre ce que l’on pourrait appeler la matérialisation de ce phénomène et ce qui l’a incitée, ce que la langue chinoise récapitule dans les notions respectives de « Terre » et de « Ciel », ou de yin et de yang. Mais, fait essentiel, les deux pôles de l’interaction ne sont pas posés préalablement à celle-ci, c’est elle au contraire qui implique ces pôles entre lesquels elle se développe. Pour reprendre l’exemple précédent, l’acte d’écriture d’un caractère, son émergence est considéré comme une interaction : non pas entre deux plans existentiels séparés (celui d’un désir et d’un schème idéel préexistant dans la conscience du scribe, et celui d’une figuration réalisée), mais alternance entre un niveau latent et un niveau patent, potentiel et actuel, sans solution de continuité, car régie par une logique d’immanence.
Le versant d’une montagne n’est jamais ombragé (ce qu’indique le caractère yin) ou ensoleillé (ce qu’indique le caractère yang) : ombragé, il l’est toujours en passe d’être ensoleillé, ensoleillé, il l’est toujours en passe d’être ombragé, à l’image de la bande de Moebius où une face est toujours en passe de devenir l’autre. Cette logique n’est concevable que dans celle de la transformation d’une forme en une autre, et non dans celle qui s’édifie sur la rupture d’une origine.
Le corps est initialement un effet de l’échange de paroles entre la mère et l’enfant ; s’y inscrivent les mots qui, conjointement aux effets de l’image dans le miroir, supporteront des repères aussi essentiels que sa situation dans l’espace, ou des différenciations telles que ce qui se voit ou non, l’intérieur et l’extérieur, ses zones et fonctions de contact et de mobilité dans le monde, orifices et lieux d’échanges et de communication ; les troubles somatiques seront référés à de tels paramètres dont la pensée chinoise renverse l’acception en y promouvant une dialectique de l’interaction.
A l’opposition, par exemple, de l’intérieur et de l’extérieur, elle substituera, à travers des caractères utilisés pour montrer l’avers et le revers d’un vêtement, ce qu’on pourrait appeler une perspective portée depuis l’intérieur (li) et une perspective portée depuis l’extérieur (biao) (cette dialectique est très utilisée dans les textes médicaux) : en ce sens, un trouble psychosomatique doit-il être considéré comme la marque non symbolisée d’un non-dit, ou d’un ratage d’une opération métaphorique, ou bien comme l’éclat du vase laissé en chemin par le lapidaire allant à la rencontre du bloc de jade, ou dans le bafouillement ou le bégaiement des échanges de parole avec l’Autre maternel ? N’y a-t-il pas là un calligramme en attente d’être tracé ou une parole d’être proférée, plus qu’un sens d’être déchiffré pour lui-même ? Qu’un tel sceau ait été un jour inscrit sur notre corps nous incite à en soutenir la gageure.
Enfin, il existe, dans la tradition chinoise, des représentations imagées du corps, notamment dans la tradition taoïste.
Cependant, ces dessins ne sont jamais l’équivalent de nos planches anatomiques, ni même une stylisation d’une sorte d’atlas des diverses parties du corps. Ce sont plutôt des tableaux, des diagrammes («tu » : ce caractère signifie également « projet, dessein ») servant de repère à la progression dans les techniques corporelles (notamment de méditation), représentant le cheminement physique et psychique inhérent à ces pratiques, les transformations du corps alors à l’oeuvre. L’appellation de telles figures en atteste largement : « Carte de la culture de la perfection », « Carte de la montée et de la descente du yin et du yang dans le corps humain » etc., qui n’indiquent que des pratiques et non une reproduction d’une quelconque réalité anatomique. Dessins figuratifs ou géométriques y côtoient des textes d’interprêtation souvent délicate.
Ces tableaux ne sont pas seulement des images figées ni même des graphes. Ce sont également des « fu », c’est-à-dire des talismans.
Le corps de l’adepte taoïste est lui-même un talisman, ayant sa contre-partie dans le monde ; ce « tableau talismanique » du corps (pour reprendre l’expression de B. Berthier-Baptandier, 1, 1993) est un diagramme que l’on « parcourt, déchiffre et intègre simultanément » (3). Il est le corps en acte.
Dans sa démarche, cet adepte reconstruit et déconstruit tout à la fois le monde et ses représentations à travers son corps, appréhendant par là même l’avant et l’après des transformations incessantes, l’alternance des apparitions et des disparitions, de « la pensée qui ne pense pas, la parole qui ne dit pas, la vérité qui ne se voit pas,…, et la multiplication indéfiniment déployée des analogies, des énumérations, des rituels et techniques… » (13, p.19).
La dimension talismanique de la carte du corps souligne à quel point le monde n’existe qu’en tant que chaque individu le constitue ; de la même façon, on peut dire que le monde n’existe pas en dehors des existants comptés un par un ; autrement dit, il n’est guère de lieu conceptuel d’où l’on pourrait considérer « objectalement » le monde ; ceci n’a rien pour nous étonner dans une culture qui n’a édifié aucune théorie de la connaissance. L’homme et le monde ne se différencient pas dans une logique de sujet et d’objet, mais se corrèlent, interagissent, dans une même « activité ».
Il est indéniable que de telles démarches (taoïstes, ou qui en sont variablement inspirées) s’étayent, plus que toutes autres, sur les jeux réciproques du langage et de l’écriture et du corps, dans ses comportements (la dimension rituelle y est essentielle) et ses éprouvés, où tout à la fois la pensée (re) prend corps et le corps se pense : recherche non tant d’un temps archaïque primordial de la naissance et des premiers échanges avec la mère et donc d’un objet, que du présent et de l’instantanéité de la mutation.
Le temps dans cette instantanéité n’est pas l’autre coordonnée de repérage d’un objet, dans un graphique temporo-spatial en abscisses et ordonnées : il est la transformation elle-même en tant qu’interaction, qui succède et précède toutes celles qui sont advenues ou à venir. N’est-ce pas cette dimension qu’obture et rate fondamentalement le phénomène psychosomatique ?
Et donc… ?
La dynamique de la cure avec des patients psychotiques consiste souvent à mettre en mots des comportements corporels - avec des enfants autistes par exemple -, ou à lier des fragments mnésiques disparates sans affect ni source d’aucun jugement, énoncés par le sujet hors de toute narration. Bien qu’il ait pu lui être comparé par certains auteurs, le contexte nous semble ici différent.
Il est factice de parler de patients psychosomatiques, comme s’il s’agissait d’une catégorie nosographique. Nous avons précisé, au début, que nous évoquions une certaine dimension psychosomatique où tout ou partie du corps échappe, dans sa prise par le langage, aux règles névrotiques. Peut être faut il tenter de déchiffrer ces phénomènes à l’instar d’hiéroglyphes comme le suggérait Lacan, rendre lisible cette signature illisible.
Mais en tout cas, le patient, de son corps ou de sa lésion, ne peut rien dire hors des mêmes phrases stéréotypées, même si les affects n’en sont pas absents (ce qui n’est pas toujours le cas) ; chez certains, le récit de la vie ne semble guère moins « opérationnel », mais pour aucune aventure nouvelle, à moins que ce ne soit celle qui les conduit parfois à l’analyse.
Le transfert, volontiers pris initialement dans cette gélification, n’est-il pas alors le pari de ce que puisse se constituer et s’énoncer une véritable fiction, - loin des rêveries habituelles de toujours, des récits organisés autour des mêmes souvenirs ou des répétitions laborieuses -, où les marques qui se révèlent (au sens du révélateur photographique) au fil de cette « écriture parlée », oserions nous dire, attestent moins d’une chose qui s’est perdue que de leur inscription même, dans l’acte de leur figuration et dans leur forme ? Dès lors, ces marques peuvent faire trace, témoin plus de ce processus scripturaire que de la fixation à un évènement ou à une position libidinale.
Le traitement de ces patients souffrant de troubles dits psychosomatiques ne peut se limiter à la recherche et à la reconstruction, à la "prise de conscience" d’un souvenir effacé, d’un évènement du passé, d’une singularité ambigue et aléatoire dans la constitution et la disposition du monde fantasmatique, d’une équivoque signifiante, à la mise en évidence d’une répétition mortifère ; s’il est difficile d’échapper à une telle tentation, qui n’est, au demeurant, pas répréhensible en soi, cette perspective s’avère, en pratique, bien insuffisante.
Le corps ne cesse de se construire et de se reconstruire, de se définir, de se délimiter, de se repérer dans des coordonnées jamais établies définitivement, restant toujours à reconsidérer selon une conjoncture donnée ; les expériences de l’enfance demeurent certes à jamais déterminantes, mais plus en tant que fondements et inducteurs des expériences ultérieures à venir qu’en tant que schèmes, moules ou modèles fixés une fois pour toutes dans leur forme et leur contenu. Telle est l’une des propositions essentielles à laquelle la vision chinoise du monde nous incite à réfléchir. L’identité y est moins conçue à partir de quelques signifiants établis une fois pour toutes que dans une logique du processus interactif ; cette problématique se décentre alors de la classique opposition entre l’architecture narcissique établie sur le monde des images et la constitution du sujet à partir des signifiants essentiels de son histoire dans les vicissitudes du réel et s’inscrivant sur un corps organique.
La prise en charge de ces patients ne gagne guère à se limiter, selon notre expérience, à une "talking cure"; un abord plus directement corporel s’avère le plus souvent parallèlement nécessaire. Les anciens chinois ne pouvaient d’ailleurs pas imaginer de négliger l’une de ces deux dimensions.
Si l’on veut bien se souvenir que le terme d'"inventer" signifie originellement l’action de "trouver et de découvrir", alors peut-être le projet à concrétiser devant ces troubles psychosomatiques consiste-t-il à permettre aux patients d’inventer leur corps, dont l’existence ne procède que de son incessante actualisation, de sa mise en forme toujours renouvelée.
Nous ne saurions mieux conclure ces quelques prémisses sur la pensée chinoise qui ouvrent peut être la voie vers un autre regard sur les phénomènes psychosomatiques qu’en laissant, là encore, la parole à Zhuang zi (chapitre 6) :
Réponse à la question : d’où avez vous obtenu le dao (la Voie) :
Je l’ai entendu du descendant de Calligraphie,
qui, lui, le tenait de l’enfant de Récitation répétée ;
celui-ci le sut de Vision de Lumière ;
Vision de Lumière l’avait reçu d’Instructions chuchotées.
Ce dernier l’avait reçu de dur Apprentissage ;
Dur Apprentissage de Chant populaire
Chant populaire d’Obscurité,
obscurité de Trois-Vide,
qui l’entendit de :
Peut être un Commencement ?
(16, pp.274-275)